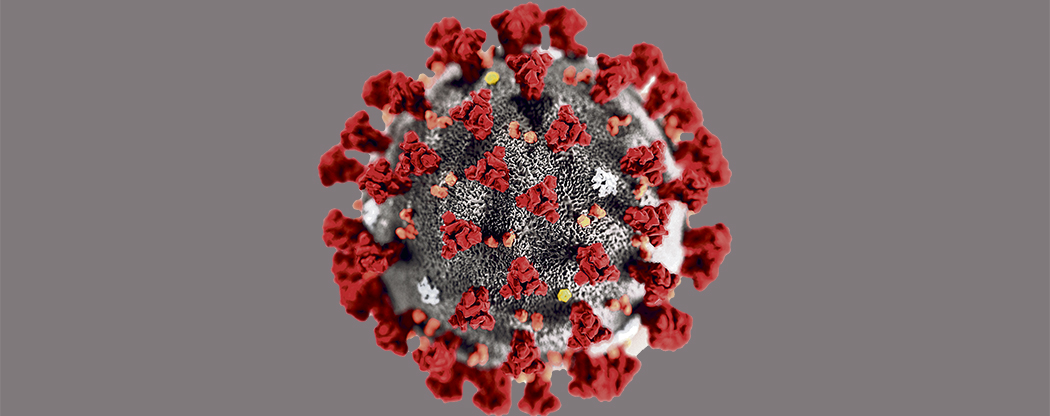Déjà en première ligne d’une crise dont les rebondissements imposent une vigilance de tous les instants, le Dr Alain Vadeboncœur s’active vigoureusement sur un tout autre front: les réseaux sociaux. Parce que la deuxième vague tant redoutée est en proie à la mise en doute, l’urgentologue et auteur ressent le devoir d’informer, quitte à devoir confronter brutalement.

© Coutoisie
Vous êtes actif sur les réseaux sociaux où la science est souvent attaquée. On y oppose des pseudo-sciences sous prétexte que toutes les opinions se valent ou qu’on nous mente, que la science conventionnelle est sous l’influence de lobbys, etc. Le ton et acrimonieux, c’est bien souvent décourageant. Ultimement, pourquoi continuez-vous d’intervenir?
Je pense qu’il y a tellement eu de désinformation, de problèmes de perception, que je me sens presque obligé de répondre. Je me dis si je ne le fais pas, si on ne le fait pas, ça laisse toute la place à des gens qui sont on pourrait dire un peu délirant. Je dois dire que depuis quelques semaines ça va beaucoup mieux, d’abord parce que j’ai bloqué beaucoup de gens (rires), mais aussi parce qu’au début, les journalistes étaient très désemparés par la crise. Ils avaient peu de connaissances, et disons que les médecins étaient très souvent demandés. J’ai fait une centaine d’entrevues depuis le début. Je sentais que les gens dans les médias avaient besoin de se rattacher à des gens qui ont une expertise. Mais depuis un mois ou deux, il y a beaucoup de journalistes qui sont devenus très ferrés et qui eux-mêmes relèvent les informations erronées. Je sens qu’ils ont moins besoin de moi.
Il y a une part de doute dans la présente crise. On a vu les scientifiques tergiverser, voire se tromper, ce qui a pu possiblement les vulnérabiliser vis-à-vis du public. Comment expliquer cette crise de confiance envers les autorités scientifiques?
Il y a deux choses très importantes dans cette question. Le doute, à la limite, et les débats, les études contradictoires (dans le milieu scientifique) c’est quelque chose de tout à fait normal. La grande différence, c’est qu’habituellement, ces débats-là, ça se passe dans des journaux scientifiques pendant quelques années avant qu’il y ait un consensus qui émerge. Quand le grand public reçoit l’information, elle est déjà largement digérée, consensuelle, les incongruités sont filtrées et corrigées, etc. Mais ce qui est particulier dans ce cas-ci c’est que la science se construit sur la place publique. Ça a exposé le processus de science, ce que les gens ne connaissent pas nécessairement. Je pense donc qu’il y avait un problème de compréhension du fonctionnement de la science, un problème de perception de ce débat-là par le public.
D’autre part, il y a eu des phases où on a mis en doute la gravité de la pandémie, la réalité de la deuxième vague, l’impact sur le système de santé, comme cet été, par exemple. La première vague était finie, certaines autorités disaient qu’il n’y en aurait pas de deuxième. C’est sûr que quand tu n’as plus beaucoup de cas, qu’il n’y a presque plus rien dans les hôpitaux, il y a tout un discours qui émerge disant qu’il n’y aura pas de deuxième vague. Tout peut devenir vrai à ce moment-là. Mais en fait ça se met à relever (le nombre de cas), comme c’est le cas actuellement.
Dans une chronique récente dans le magazine L’actualité, vous dites que la crise a exposé les failles du système de santé québécois. Vous l’avez vu et le voyez encore, de l’intérieur. Quels sont certains de ces dysfonctionnements ayant exacerbé la crise?
Les principaux effets de cette crise-là sont beaucoup en lien avec l’état du système. Si on pense à la précarité de l’emploi dans les centres de soins de longue durée, on a vu que ça a eu des conséquences directes assez évidentes. Ça a joué même un rôle dans la transmission d’un endroit à l’autre, parce que la précarité vient avec de la mobilité. Ça été un facteur majeur dans le déploiement de l’infection. C’est un exemple qui montre que face à cette pandémie-là, il y a des conditions connues depuis longtemps qui étaient en place et qui n’ont jamais vraiment été corrigées et qui ont joué un rôle au cœur de l’infection elle-même.
La deuxième chose, c’est qu’on a tendance à gérer beaucoup selon le principe de «juste à temps» donc à ne pas avoir assez de réserves d’équipements de protection, par exemple. Alors on se fie beaucoup à des chaînes d’approvisionnement. Mais ces chaînes-là se sont brisées. Par exemple, des fournisseurs en Chine ont été affectés par la pandémie, et aussi parce qu’à partir du moment où la pandémie a avancé, bien tout le monde avait besoin de matériel en même temps. Ça a créé des ruptures dans les chaînes d’approvisionnement. Le manque de protection pour le personnel a contribué à en infecter plusieurs et par ricochet, à en infecter d’autres notamment dans les hôpitaux et les CHSLD.
Certaines conséquences découlent donc de problèmes systémiques. Mais la crise contient aussi une grande part d’inconnu. En tant que chef du département de médecine d’urgence de l’Institut de cardiologie de Montréal vous gérez des crises au quotidien. Là, c’est une crise prolongée, à grande échelle, inédite. Qu’est-ce que cette pandémie vous a révélé sur votre métier?
Sur un plan personnel, celui du travail de médecin, c’est sûr que ça a été des mois difficiles. Ça change considérablement la relation que tu as avec le risque. Veut veut pas, et c’est encore plus vrai avec les préposés et les infirmières, ta «job» c’est d’aider le monde, de les soigner. Mais on n’est pas là pour se sacrifier non plus. Quand tu regardes le nombre de préposés, infirmiers et médecins qui ont été infectés et avec des conséquences graves, tu te dis que clairement tu t’exposes simplement en faisant ton travail normal.
J’ai eu un groupe d’infirmières et de préposés qui sont allés travailler dans un CHSLD qui était en détresse. Ces gens-là se sont rendus là avec tout leur équipement, leur professionnalisme, leurs façons de faire, tout était bien ficelé, mais malgré tout il y a eu au-delà d’une trentaine d’infections dans le groupe. Autrement dit, tu as beau faire tout ce que tu peux, tu es quand même en position de vulnérabilité. Ça change pas mal la relation et surtout pour les infirmières, il y a eu beaucoup de départs de la profession à Montréal dans cette période-là. Les gens se remettent beaucoup en question. Est-ce que vraiment les personnes veulent vivre ce risque-là dans le cadre d’un travail ? Je comprends bien ça.